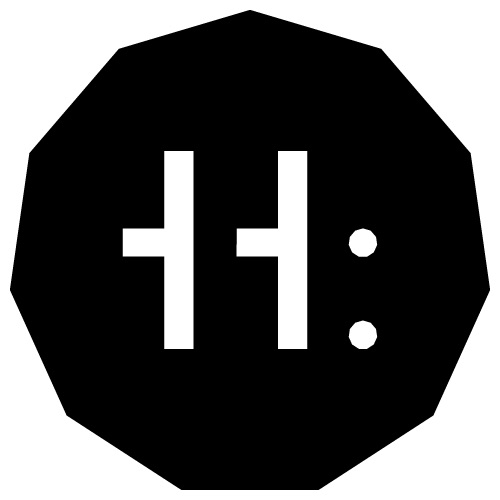Arrivée de Marseille en 2013, Catherine Marnas dirige depuis 4 ans le Tnba.
Mais elle n’est pas seulement directrice de théâtre national, c’est aussi une metteure en scène passionnée qui présente cette année deux créations: 7 d’un coup et Mary’s à minuit. Nous sommes allés à sa rencontre pour découvrir l’itinéraire de cette artiste qui cherche du côté de ce qui fait souffrance et surtout, de ce qui fait survie.
Vous vous êtes formée avec Antoine Vitez et Georges Lavaudant. Qu’est-ce que ces deux hommes ont apporté à votre travail et à votre rapport au théâtre ?
Ils ont un rôle très différent. Mon père de théâtre, c’est Antoine Vitez et Georges Lavaudant est plus un grand frère, pas en terme de génération, mais plutôt dans le rôle qu’ils ont eu pour moi.
J’ai décidé de faire de la mise en scène très jeune. J’ai découvert le théâtre j’avais 12 ans, c’était par l’école, et j’ai tout de suite su que je voulais être metteure en scène, pas comédienne. Ensuite, je suis allée à l’université, je faisais ma thèse de doctorat sur Antoine Vitez. Je savais que j’avais envie de travailler et d’apprendre le métier de metteure en scène avec lui, de me frotter à cet homme, qui était non seulement un grand metteur en scène, mais aussi un grand penseur et un grand pédagogue. Alors bien sûr, quand on le dit comme ça, ça à l’air facile mais ça a été tout, sauf facile. Il a fallu que je m’accroche. J’ai vraiment fait des pieds et des mains pour y arriver, ce qui est un message d’espoir pour tous ceux qui veulent quelque chose. J’ai d’abord été acceptée comme stagiaire lorsque j’écrivais ma thèse ; thèse qui d’ailleurs, faisait beaucoup rire Antoine Vitez. C’était la pleine époque de la sémiologie et le tire était « Tentative de grammaire des déplacements dans les mises en scène d’Antoine Vitez ». Je me souviens, j’avais décliné des choses récurrentes ; entre autres, que la diagonale chez Vitez était la trajectoire de la douleur. Alors ça, ça l’avait beaucoup fait rire, rire et intéressé, et à chaque fois qu’il faisait une diagonale, il disait « On va se faire une trajectoire de la douleur ». Il m’a ensuite prise comme deuxième assistante. Ce qui était formidable avec Vitez, c’est que c’était un maître. D’ailleurs, c’est la seule personne que je connaisse qui revendiquait ce terme, et pour lui ce n’était pas de l’orgueil, c’était de l’humilité d’accepter ce rôle de transmission. C’était un vrai maître. Je l’observais réaliser ses mises en scène, je le voyais diriger les acteurs. Il se débrouillait toujours pour que je comprenne, sans me le dire explicitement comme on peut faire une psychanalyse didactique. Il faisait de la mise en scène didactique. Ça a été une expérience extraordinaire. Ça, ce sont les fondations.
Après, j’ai fondé ma compagnie, j’ai monté mes premiers spectacles. J’ai rencontré Georges Lavaudant, il arrivait de Grenoble et s’installait à Lyon, il avait besoin d’un coach de Bulle Ogier. Ce binôme a fonctionné pendant très longtemps, mais c’était un peu différent. Je refusais d’être permanente, je pouvais dire non sur certains projets et travailler sur mes propres mises en scène. Néanmoins, Lavaudant m’a transmis beaucoup de choses, une technique au service d’une poésie scénique.
C’était très complémentaire. Vitez un littéraire et un politique, Lavaudant un poète de la scène. Lavaudant maîtrisait l’univers plastique, le son, la lumière, comme un peintre ; les lumières n’avaient pas de secret pour lui. Vitez, vous lui parliez d’un projecteur, il ne savait pas ce que c’était, l’éclairagiste suivait.
Vous dites que Koltès est votre auteur favori. Qu’est-ce qui vous plaît dans l’univers de Koltès ?
Ma rencontre avec Klotès a été très bizarre. Tous les metteurs en scène ne vivent pas ça. Ça a été un coup de foudre, au sens littéral, comme un coup de foudre amoureux mais pour une écriture. Quand je travaillais au TNP avec Georges Lavaudant, une secrétaire était en train de taper le texte de Roberto Zucco que Piccoli devait venir lire avant la création. Elle m’a passé le texte, je l’ai lu et je suis tombée totalement en arrêt. J’ai eu la sensation de reconnaître des mots, comme si je les avais écrit moi-même, comme si les choses que j’aurais toujours voulu écrire étaient là. Je m’en souviens très bien, c’était la scène qui s’appelle « juste avant de mourir ». Ce monologue m’a fait tomber en arrêt, comme si je me disais: « mais j’ai écrit ça, ou dans une vie antérieure ou je ne sais quoi ». En plus, Koltès croyait beaucoup à cette idée de la vie antérieure, comme lorsque Léone dans Combat de nègre et de chien peut reconnaître des Bougainvilliers alors qu’elle n’en n’a jamais vu. J’ai eu cette sensation-là. J’ai choisi de monter Zucco au Mexique et j’ai travaillé toute son œuvre. Je ne suis pas sûre qu’il y ait une telle obsession maniaque, à propos d’un auteur, de la part de tous les metteurs en scène. Ce travail m’a structurée. Je pense que je n’ai plus mis en scène ou plus dirigé les acteurs ou même fait de la formation d’acteurs, de la même manière après avoir travaillé l’œuvre de Koltès.
Lors de vos trois derniers spectacles « Ligne de faille », « Lorenzaccio », « Les comédies barbares » vous vous êtes attelée à des œuvres fleuves. Qu’est-ce qui vous a donné envie d’aller dans cette difficulté-là ?
Pour moi, c’est un hasard. Il n’y en a certainement pas, mais peut-être que je ne peux ni le voir, ni l’analyser. Pour Ligne de faille, j’étais à un moment de ma vie douloureux, ça je le dis maintenant, je ne l’aurais pas dit lors de la création. J’avais un sentiment d’impuissance, j’étais face à un ressenti d’injustice. J’avais l’impression d’être au sol. Et j’ai découvert ce magnifique roman de Nancy Huston, qui traite de l’impuissance de l’enfance, de ces douleurs qui nous rattrapent dès que ça ne va pas, dès qu’il y a un traumatisme, un échec ; de ces traces-là, ces cicatrices-là, qui reviennent. Et quand j’ai dit à mes acteurs que je voulais m’attaquer à ce roman, ils m’ont dit : « Tu es sûre ! » Mais face à ce thème et à cette remontée dans le temps qui me semblait très théâtrale, je me suis dit : « Tant pis, la longueur n’est qu’accessoire ! » On ne peut pas rendre compte totalement d’un roman. C’est ce que je disais aux acteurs avec qui je travaille: « Comme c’est impossible, alors tout est possible. » Et je crois que c’est cette liberté-là qui m’intéresse.
Cette fois-ci, avec votre nouvelle création « 7 d’un coup », vous décidez d’aller vers le conte. Est-ce la première fois que vous faîtes un spectacle à destination des enfants ?
C’est le troisième spectacle. J’avais écrit une adaptation de La tempête de Shakespeare pour des enfants à partir de six ans. Ensuite, j’ai fait un opéra tout public, d’un texte d’Olivier Py « Le diable, la jeune fille et le moulin », pour lequel j’avais fais une adaptation pour enfants avec un comédien et des marionnettes.
Dans 7 d’un coup, je voulais parler, comme dans Ligne de faille, de l’enfance et de cette impuissance, c’est un peu la suite pour enfants. Je voulais aborder un thème dont j’entends beaucoup parler et qui me préoccupe, parce que je vois la souffrance que ça peut représenter, le harcèlement à l’école. Je pense que ça devient un vrai problème, même si ça a toujours existé, je trouve que ça prend des proportions beaucoup plus importantes et les réseaux sociaux n’y sont pas totalement étrangers. Alors bien sûr, il y a des moyens pour lutter : il y des associations, les professeurs sont alertés, il y a des campagnes nationales contre le harcèlement. Mais, je me disais que le théâtre pouvait aussi être un outil pour faire catharsis. Comme le théâtre à beaucoup à voir avec la nuit, avec les rêves , que par le biais du conte, c’est à dire de l’inconscient, du rêve, du fantastique, on pouvait peut être arriver à soulager les enfants, qu’ils soient du côté du harceleur ou du harcelé, arriver à les libérer de cette souffrance d’une autre manière, sous une autre forme. Ce qui est formidable dans la tradition des contes, c’est leur intemporalité et leur universalité qui traverse les générations, les pays et ils sont à chaque fois réinterprétés. Nous connaissons plus les contes de Grimm, mais il y a des centaines de contes depuis la nuit des temps. C’est pour toutes ces raisons que j’ai eu envie d’écrire cette pièce. Dans 7 d’un coup, ce qui diffère du conte, c’est que le petit tailleur y arrive parce qu’il a des mots, parce qu’il s’accroche à la fiction, à la littérature, à ses rêves, mais aussi parce qu’un changement d’attitude, de réaction de ses copains, sur un malentendu, permet d’inverser le mouvement. Ce qui reste du conte initial, ce sont les 7 mouches, la rencontre avec les géants, c’est à dire les épreuves initiatiques transformées, et puis bien sûr la princesse et le roi. Mais le travail de réécriture rend le conte très différent.
Vous allez monter « Mary’s à minuit » en 2018, vous l’aviez déjà monté en 2001. Qu’est-ce qui vous a donné envie de retourner explorer ce texte ?
J’aime bien l’idée de reconfronter des écritures à l’époque. De me questionner sur : « Comment moi, comme metteure en scène, je vais m’attaquer à ça aujourd’hui ? Qu’est ce qui a changé, en moi, dans le monde, dans notre perception ? » Je trouve ça passionnant, d’autant plus, que c’est un texte avec une part sensible, mais aussi avec un comique de l’absurde important. Et il y a dans le comique de l’absurde, une sorte de test sur l’époque et sur la culture qui est très fort.
Vous dites que vous défendez un théâtre « généreux et populaire ». Qu’est-ce que cela signifie pour vous, quel type de théâtre cela représente ?
Ce qui m’embête c’est que j’ai défendu ça à un moment où ça n’était pas du tout à la mode, et maintenant, c’est revendiqué par tout le monde. J’en arrive presque à ne plus le revendiquer, alors que c’est toujours le cas. J’estime que le théâtre doit être accessible à tout le monde, ce qui ne veut pas dire qu’il doive faire des concessions pour se mettre à la portée de tout le monde.
J’aime beaucoup la métaphore qu’employait Wajdi Mouawad par rapport aux églises : il y a le Sacré Cœur, qui se mérite : il faut se taper un grand nombre de marches pour accéder à ce sacré là ; et puis, il y a Notre-Dame : on franchit simplement la porte et on se retrouve en présence du beau, du sacré et je pense que c’est ce que j’essaie de faire. D’abord, dans ma direction du théâtre, je cherche à ce que le théâtre ne soit réservé ni à une classe sociale, ni à une classe d’âge mais au contraire qu’il puisse toucher tout le monde, ce qui ne veut pas dire que tout le monde doit venir au théâtre, mais que tout le monde doit pouvoir y venir, ce n’est pas la même chose. On a tout à fait le droit de ne pas aimer le théâtre, mais encore faut il avoir la possibilité d’y venir et d’avoir un libre choix. Donc pour permettre cet accès, il y a un énorme travail invisible de la part de mes équipes et de moi-même. Et puis dans mes spectacles, ce que j’appelle la main tendue, c’est à dire une forme de théâtre qui peut embarquer les gens en tendant les mains et non pas en se renfermant sur des codes qui seraient des codes de l’entre-soi.
En parlant d’ouverture, vous avez le projet « Égalité des chances » pour permettre l’accès à la préparation et au concours de l’ESTBA à des jeunes ne bénéficiant pas d’un environnement incitatif ni de moyens financiers suffisants. D’où vient cette envie ?
A l’ESTBA, on est déjà extrêmement attentifs à cette notion d’égalité des chances dans le choix des élèves de l’école. C’est à dire que le jury, est très attentif à ça dans la manière d’aborder les entretiens, ne serait-ce qu’en étant attentif à des inégalités culturelles, en ne jugeant pas des qualités de l’acteur uniquement sur le brio et la performance. Faire un théâtre de création, c’est aussi, parfois, toucher quelqu’un qui n’y aurait peut-être pas pensé. Je pense à une jeune fille qui était en école d’architecture, qui a travaillé avec nous sur la scénographie des Comédies Barbares, et qui maintenant fait l’école du TNS (théâtre national de Strasbourg). Il est bien évident que si ce centre n’était pas un centre de création, elle n’aurait jamais eu l’idée de faire cette formation. Mais on s’est dit : « Est-ce que géographiquement et culturellement, dans cette grande région, on arrive à toucher tout le monde ? Comment toucher des personnes au delà de Bordeaux, ou dans des milieux où on n’entend peut-être pas parler de théâtre. Comment est-ce qu’on peut leur tendre la main? Comment faire toucher le théâtre à ces jeunes-là et peut-être révéler des passions qui seraient restées frustrées, s’il n’y avait pas cette possibilité de stage et de rencontre ? »
Photos : 3 portraits de Catherine Marnas par Antoine Delage
Les créations de Catherine Marnas à voir au TNBA :
- 7 d’un coup du 21 novembre au 2 décembre 2017
- Mary’s à minuit du 23 janvier au 9 février 2018