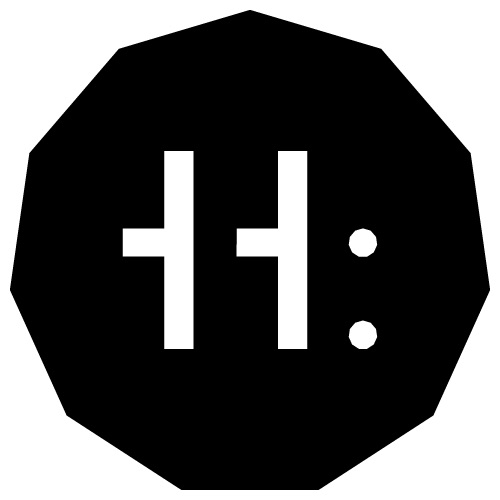Rencontre avec Christophe Dabitch, auteur et scénariste de bande dessinée — entre autres — qui nous emmène de l’autre côté de la rue aussi bien que de l’autre côté de la mer dans ses différents livres. Travaillant seul pour la première fois sur un ouvrage, il revient aussi sur ses précédentes collaborations et nous parle sa vision de l’écriture.
Paula : Vous avez fait plein de choses dans votre vie : vous avez été journaliste, critique littéraire, auteur, scénariste BD. Comment tout ça s’est mis en place ? Vous avez commencé par quoi déjà en fait ?
Christophe Dabitch : J’ai fait des études de lettres, un peu de sciences politiques. J’avais envie d’écrire, d’une manière ou d’une autre. Le journalisme c’est une porte d’entrée. J’avais sans doute envie de sortir de l’endroit d’où j’étais, de voyager et puis j’étais curieux de différents milieux sociaux, de connaître, de rencontrer les gens. Donc c’est un mélange un peu de tout ça qui m’a amené vers le journalisme dans un premier temps.
Ensuite j’ai commencé par publier plutôt des livres d’Histoire. Pour la bande dessinée, j’ai rencontré des amis dessinateurs. La première ça a été pendant un voyage en Afrique avec le dessinateur Jean Denis Pendanx (bande dessinée : Abdalli).
J’ai fait un petit peu de documentaire aussi dont le premier était en ex-Yougoslavie. C’est une histoire personnelle que je poursuivais un petit peu, puisque je suis d’une lointaine origine yougoslave. J’ai de la famille à Belgrade. Je les ai retrouvés peu de temps avant que la guerre ne commence. Ça s’est traduit à un moment donné par un film. Ensuite j’ai continué à faire un peu de magazine, de documentaire, mais c’est un milieu où les contraintes financières sont fortes. Après un ou deux échecs sur lesquels j’avais beaucoup travaillé et que je n’ai pas réussi à financer, j’ai lâché un peu cette partie là. Peut-être que ce n’était pas là où je devais être : il y a des choses qu’on abandonne et il y a des choses qu’on poursuit.
P. : J’imagine que dans votre écriture vous vous resservez un peu de tout ça.
C.D. : Oui, après l’écriture elle se fait avec l’expérience, avec les lectures, les rencontres. C’est vrai que dans ce que je fais il y a souvent une base documentaire, qu’elle soit historique, contemporaine, en lien avec des formes différentes de reportage. J’aime bien partir de quelque chose de réel et d’en faire autre chose, tourner autour, imaginer quelque chose à partir de ça, interroger un peu une situation. J’ai fait plusieurs livres sur des personnages historiques, qui sont en général plutôt des marginaux de la grande Histoire (Jeronimus). Quand on parle des autres, on parle beaucoup de soi, il y a des choses très personnelles que tu y mets sous prétexte de raconter l’histoire de la vie de quelqu’un d’autre.
P. : Donc il y a un côté un peu cathartique ?
C.D. : Je pense que pour les gens qui écrivent, il a toujours une forme de vide un peu central. Donc tu construis des choses sur ce vide sur lesquelles tu peux prendre ensuite appui. Cathartique, ça voudrait dire qu’on se libère de quelque chose. Ça pourrait être ça, mais je n’y crois pas forcément.
P. : C’est une question, peut-être, d’empathie qui fait effet miroir sur certains aspects alors ?
CD : Oui, l’empathie, la sympathie, la proximité ou le fait d’arriver à se mettre à la place de quelqu’un d’autre. J’ai fait un livre comme ça avec Amnesty International (Être là, avec Amnesty International) autour des droits humains. Je suis allé dans plusieurs pays et j’ai rencontré des gens qui étaient en situation de combat disons pour eux, pour leur humanité, pour leurs droits. J’ai développé tout un discours où je disais que je me méfiais beaucoup de l’empathie. Je trouve ça compliqué de se mettre à la place de l’autre, sachant que se mettre à sa propre place ce n’est déjà pas facile. Donc je parle plus de sympathie, c’est-à-dire d’être avec quelqu’un.
Ma première bande dessinée a été ça. J’ai écrit sur René Caillié, un explorateur Français du XIXe qui a traversé l’Afrique de l’Ouest (Abdalli). Il s’est fait passer pour musulman, pour Egyptien, c’était un voyage de deux ans à pied en solitaire, une épreuve physique terrible, donc très intriguant. Je n’ai pas adapté son récit mais j’ai respecté ce qu’il avait traversé, enfin ce qu’il en disait en tous cas. Par contre j’ai essayé de construire un récit intime à la première personne sur ce qu’il avait traversé, enfin ce que lui ne disait pas. Tu fais une hypothèse de récit à partir de ce que tu imagines, mais ça reste une hypothèse donc il faut essayer de rentrer dans la tête, dans un parcours, dans des sensations, et c’est quelque chose qui est vraiment intéressant.
« Je trouve ça compliqué de se mettre à la place de l’autre, sachant que se mettre à sa propre place ce n’est déjà pas facile. »
P. : Vous avez mentionné que vous aimez avoir une base documentaire. Comment se passent vos recherches ?
C.D. : Quand c’est un personnage lointain dans l’Histoire, c’est de la documentation livresque, en archives. Comme l’Histoire est un puits sans fond, tu peux rechercher sans arrêt, continuer, il y a toujours des ramifications, il y a forcément un moment de saturation où tu n’en peux plus de cumuler, de rechercher. C’est là où il faut que ça bascule sur quelque chose de personnel, que ça suscite l’imaginaire. C’est à partir de ça, non pas qu’on s’en libère, mais qu’on en sort un petit peu pour créer quelque chose.
Il y a une bande dessinée que je vais publier l’an prochain qui est autour d’une femme qui s’appelle Eugénie Guillou. C’est une jeune femme qui a été nonne pendant une quinzaine d’année, à qui on a refusé de prononcer ses vœux et qui est réapparue à Paris. Elle est devenue spécialiste de la fessée et des mises en scènes sexuelles, mais aussi une femme indépendante avec un discours proto-féministe. Je suis allé aux archives de la Police à Paris où il y avait un dossier sur elle avec pas mal de choses. J’ai mis longtemps avant de trouver comment rentrer dans cette histoire et comment la raconter. Je ne voulais pas faire une sorte de biopic aguicheur. À un moment donné j’ai commencé à construire un récit qui mêle une partie bande dessinée et une partie texte, où il y a un rapport entre le narrateur et le personnage qui voit ce que fait le narrateur de son histoire, qui sait tout au long du livre ce qu’il est en train de faire avec sa vie et qui la défend en fait. Ça a été assez long, j’y ai passé un an et demi, enfin pas que ça, mais j’ai passé un an et demi avant de trouver la forme. Pour le coup, il y a aussi de la documentation puisque c’est fin XIXe début XXe et c’est aussi un milieu particulier, celui de la prostitution. Le truc c’est d’arriver à être juste, de ne pas forcément « faire réaliste » ou d’être conforme historiquement, mais quand même d’être juste.
P. : Vous avez été scénariste pour de nombreuses BD : on a parlé d’Abdalli et Jeronimus avec M. Pendanx ou encore Ligne de fuite et Mauvais garçons avec Benjamin Flao. Comment ça se passe le travail avec le dessinateur ?
C.D. : Forcément on aime le travail de l’autre, ça doit être réciproque. Après il y a une rencontre personnelle, donc c’est le prolongement de ça. Suivant le dessin et le dessinateur, c’est comme si j’explorais des voies un peu différentes, sur la manière de mettre en scène, sur la narration, sur le dessin même qui se prête plus ou moins à des formes d’histoires. Par exemple, Benjamin Flao, c’est quelqu’un qui travaille énormément pour donner cette impression, où on dirait un crayonné qu’il a fait dans l’instant. Il a une rapidité d’exécution, une énergie, il est très bon dans le mouvement et dans la vie. Ça implique des choses dans l’écriture. Jean-Denis Pendanx a travaillé à la peinture. Ce n’est pas du tout la même approche. Tu peux aller dans des choses plus contemplatives, d’autres plus narratives avec une forme de rapidité et d’énergie. Quand j’écris, je pense au dessin, et c’est comme si je l’adressais à quelqu’un.
J’ai une autre écriture qui est ouverte. En fait j’essaie de raconter l’histoire au dessinateur donc il y a une partie de l’écriture qui va disparaître, il y a les dialogues, les textes narratifs éventuels qu’il y a dans l’histoire. Mais je laisse au dessinateur l’interprétation, la mise en scène, le nombre de pages pour telle séquence, le nombre de cases. Il faut qu’il se sente libre d’amener son univers en lien avec ce que j’ai écrit. Ce qui fait que si on réussit, on crée un troisième truc qui est le fruit du mélange entre le texte et le dessin.
Quand j’écris le scénario, il y a un temps où je suis un peu tout seul, mais on discute. Après je l’envoie, les dessinateurs font ce qui s’appelle un crayonné – c’est-à-dire, un premier découpage global – ce qui nous permet de voir le nombre de pages qu’on va atteindre, voir la construction des grandes séquences, les personnages… On discute un petit peu. Après, c’est le dessinateur qui se lance dans le travail. Le dessin est généralement plus long que le temps de travail du scénariste.
P. : Vous avez aussi collaboré avec des photographes. Le travail est-il différent ?
C.D. : Ce n’est pas le même rapport parce qu’on cherche ensemble les liens entre les deux, alors qu’en bande dessinée, j’écris un scénario que je donne à l’autre et qui va en faire une forme. J’ai fait trois livres avec Christophe Goussard qui est un photographe Bordelais : le livre en Syrie (Les Autres, balade Araméenne); le livre sur l’estuaire (L’Adieu au fleuve) qui est un récit tête bêche, on a chacun notre récit, tu as une entrée texte, tu retournes le livre et tu as une entrée photo; et un livre où on suit une compagnie de hip-hop d’Hamid Ben Mahi pendant la création d’un spectacle autour de Bashung (Le Corps juste).
Dans le dessin il y a une séquence en cases, donc une narration. Dans la photographie c’est une série de photos uniques qui figent ou arrêtent un instant. Et ce qui est intéressant c’est la manière dont tu vas pouvoir tirer un peu le lien entre les deux. De s’éloigner, se rapprocher, d’être très redondant presque, jusqu’au moment où ce sont des échos et des correspondances qui sont autres. C’est le lecteur qui fait le lien entre le texte et l’image. Ce qui est propre à la bande dessinée donc la séquence narrative, certains photographes le travaillent aussi: il y a des narrations moins évidentes qu’en bande dessinée mais il y en a quand même.
P. : Vous avez aussi écrit un premier livre seul, en tant qu’auteur : Azimut Brutal, chez Signes et Balises, sortie le 16 novembre. Il s’agit d’une promenade sur le long de le 45eme parallèle.
C.D. : Ce livre c’est une invitation d’un photographe, Nicolas Lux, qui a eu envie de faire un voyage proche de chez lui. Il m’a invité avec un compositeur, Frédéric Roumagne, dans le but de faire une exposition à l’espace culturel Mitterrand à Périgueux. L’idée c’est de traverser un territoire en ligne droite, le plus possible, en suivant le 45ème parallèle nord qui traverse l’Aquitaine, qui est une frontière invisible – il n’y a rien de part et d’autre. C’est l’idée d’entrer dans le paysage et de traverser avec une contrainte forte et peut-être de le regarder autrement.
Je voulais essayer de faire un récit dans et face au paysage. Ce n’était pas prévu au début que j’écrive un livre, c’était un travail pour l’expo. Puis en fait, ça m’a inspiré : j’ai écrit un récit, qui est une sorte de traversée poétique, à la fois documentaire et poétique, de ce bout de territoire. Je ne sais pas trop comment en parler en fait, ça me renvoie à quelque chose d’assez personnel, à d’autres voyages d’ailleurs. J’ai essayé d’écrire aussi là-dessus. L’intérêt c’est aussi de le faire dans un univers que tu connais en gros, puisque ce sont des paysages d’ici, et en même temps il s’agit de les regarder autrement.
P. : En regardant un peu ce que vous avez fait, on se rend compte que vous avez quand même un thème privilégié: celui du voyage.
C.D. : Oui un peu. J’ai besoin de l’idée du déplacement. J’en suis curieux, ça m’apporte plein de choses, ça m’inspire pas mal. Tu sors du monde dans lequel tu es et tu rencontres, tu découvres. C’est dur d’être vraiment ouvert à ça, de ne pas se déplacer et de rester quand même fermé sur ces choses.
P. : Cette tension, vous la ressentez quand vous êtes assis à votre bureau et que vous travaillez avec vos personnages qui voyagent ?
C.D. : Oui, tu as les voyageurs de bibliothèque et les voyageurs concrets. Je ne sais plus quel auteur en parlait de ça: tu as le voyage premier, le voyage second. Je le ressens. Il y a des temps laborieux dans l’écriture mais ce que tu recherches toujours ce sont les moments où tu n’es pas en position de contrôle de ce qui se passe.
Tu vois, sur les lieux, j’ai écrit une bande dessinée qui se passe à Venise. Là c’est une invitation d’un dessinateur qui s’appelle Pierrot Macola, qui lui est Vénitien. Il avait juste une vague idée de récit, d’un point de départ, et il m’a proposé de venir à Venise mais il ne voulait pas que ça soit dans Venise. Ses parents ont une barque et donc on a sillonné la Lagune dans tous les sens. C’était super parce que l’histoire est arrivée petit à petit à partir des lieux. Dans l’écriture, il y avait à la fois des trucs personnels mais en même temps, il fallait que je sois attentif, que j’aille dans sa direction. Parce que tu vois, il a l’expérience du lieu, il va le retranscrire dans le dessin. Il a eu une partie du travail qui était « sur mesure ». Mon éditeur m’a dit « tu as fait un travail de couturier ! ».
Un de nos supers photographes était aussi présent et a posé une question. Anthony : C’est plus simple pour vous d’écrire sur un endroit que vous ne connaissez pas ou peu, comme c’était le cas pour Venise ?
C.D. : Dans les bouquins que j’ai écrit, il y a une partie qui sont ailleurs, lointains. J’ai aussi écrit un livre sur le marché des Capucins par exemple, qui est très proche. J’ai l’impression d’être toujours dans la même intention, dans la même recherche mais ça ne se traduit pas de la même manière. Quand j’écris autour de l’estuaire de la Gironde, il se trouve que c’est un endroit que je connais depuis que je suis gamin: c’est quelque chose de très intime, c’est une perception qui est la mienne. Quand c’est loin, c’est autre chose: il faut arriver à connaître, à sentir. C’est là que tout le truc d’empathie est assez fort. Mais ce n’est pas plus facile l’un ou l’autre.
Toujours plus !
Tout récent :
Azimut brutal, C. Dabitch, Signes et Balises, publié le 16 novembre 2018
A paraitre :
Vies de Sainte Eugénie, C. Dabitch et J. Gonzales, Futuropolis, sortie avril 2019
Lagunes, C. DAbitch et P. Macola, Futuropolis
L’ouvrage choucou de Paula :
La Ligne de fuite, C. Dabitch et B. Flao, Fururopolis, 2007