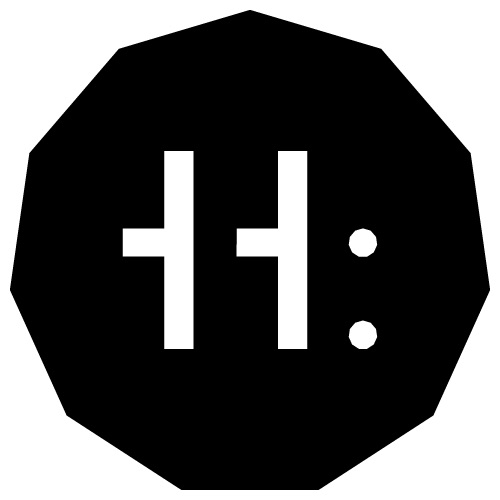Habituée aux canulars théâtreux et performances foutraques, la compagnie dijonnaise des 26000 couverts vient ce week-end au Carré de Saint-Médard-en-Jalles nous présenter leur dernière création intitulée A bien y réfléchir, et puisque vous soulevez la question, il faudra quand même trouver un titre un peu plus percutant. Une pièce faussement branlante mais en tout point brillante, aussi désopilante que déconcertante. Et pas tout à fait aussi inachevée que le titre le laisserait présager…
Rencontre avec le gourou de cette joyeuse bande d’agitateurs qui nous livre quelques-uns de ses secrets de fabrication. Ou comment se jouer des codes du théâtre pour notre plus grande rigolade.
Bonjour Philippe. Avec tous ces Philippe qui prolifèrent dans la pièce, êtes-vous le vrai Philippe Nicolle ?
Ha ha, bonne question ! On va dire que, oui, c’est moi pour aujourd’hui.
Quelle a été le processus de création de cette nouvelle pièce, en particulier la complémentarité entre le texte écrit et le travail collectif ?
Il n’y a pas eu un texte préliminaire, le texte est arrivé après. C’est vrai qu’il y a eu un travail un peu plus poussé sur l’écriture de cette pièce parce que le sujet, l’axe le demandait. C’est aussi pour ça que je me suis adjoint les services d’un camarade à moi, Gabor Rassov, qui m’a bien épaulé sur cette écriture. Le scénario est assez tortueux. Il y a beaucoup de « surprises » dans le spectacle, et au fur et à mesure qu’elles apparaissaient, il m’a semblé intéressant de les combiner, de les articuler dans un texte assez complexe pour arriver à un spectacle complètement baroque.
L’intérêt par rapport aux autres spectacles, c’est qu’il a nécessité une vraie concentration sur l’écriture à proprement parler.
Le texte de Gabor Rassov et son rôle font partie intégrante de la pièce et servent à interroger la nécessité de faire appel à un auteur. Quitte à ce qu’il s’en prenne plein les dents !
Oui ! Ça tombait particulièrement bien parce que Gabor a ce regard très second degré sur la place du sacro-saint auteur de théâtre. Je ne veux pas cracher sur les auteurs mais c’est toujours un peu délicat pour un metteur en scène et une compagnie de travailler avec un auteur de théâtre parce qu’on est dans un rapport de sacralité qu’on ne retrouve pas du tout au cinéma où le script est là pour être remanié, retraité, interrogé en permanence jusqu’au tournage. Au théâtre, il faut souvent respecter la moindre virgule et c’est parfois fastidieux !
C’est la raison pour laquelle je ne monte pas de texte en général, notamment des textes contemporains.
Alors que Gabor a ce côté complètement décomplexé, sans aucun ego. Il est hors du « sérail », notamment parce qu’il est surtout scénariste de cinéma (il a écrit pour le réalisateur Samuel Benchetrit entre autres). Il a ce côté humble et joueur. Cette capacité à se remettre en question.
On est complètement sur la même longueur d’ondes.
En plus il est chauve et supporter du PSG, ça en fait une cible facile !
Pour revenir sur cet aspect rigide du théâtre, vous remettez beaucoup en cause les codes et conventions théâtrales. Est-ce un moyen d’amener le spectateur à partager cette réflexion sur ce qu’est le théâtre aujourd’hui ?
Absolument, en tout cas, j’espère. Il y a toujours eu l’aspect accessible dans les 26000. C’est très important que ce qu’on raconte puisse être perçu par des gens riches, pauvres, cultivés, pas cultivés, jeunes, vieux. C’est une grande part de ma démarche : réhomogénéiser une population et attirer de nouvelles personnes au théâtre. Et participer à une forme d’éducation populaire.
A bien y réfléchir est un spectacle à plusieurs niveaux : on peut avoir une lecture assez proche de ce que j’ai pu y mettre (comme vous le faites), ou y voir surtout des gags d’une bande de joyeux drilles qui galèrent un peu ensemble. Chacun, j’espère, peut y trouver midi à sa porte.
Par rapport à votre historique de compagnie de rue, la pièce questionne beaucoup l’espace de représentation entre la rue et la scène.
Vous êtes-vous définitivement embourgeoisé en « troupe d’intérieur » ou un retour à la rue est-il envisageable ?
Un peu des deux. Peut-être pas un embourgeoisement mais une évolution. Mais il n’y a pas que nous qui avons changé, la rue elle-même a changé ! Je ne veux pas faire les anciens combattants mais c’est n’est plus du tout les mêmes conditions de travail qu’il y a 20 ans. Maintenant, beaucoup d’idées sont impossibles à mettre en œuvre : « vigipirate », la peur du « risque » dans l’espace public. Le risque zéro fait qu’à la fin, on a les mains coupées et qu’on ne peut plus rien faire.
Cela dit, on se réattaque à ça puisque le prochain projet sera un spectacle de rue !
Dans la pièce, on retrouve beaucoup cette idée d’opposition entre la vie et la mort : la vie serait ce travail de répétition, de création en mouvement, alors que la représentation théâtrale serait figée et définitive, comme une petite mort.
En abordant ce « work in progress », n’est-ce pas justement garder cette liberté de maintenir les choses en potentielle évolution ?
Tout à fait, c’est exactement l’idée. Mais il y aussi un aspect plus satirique, plus insolent, plus gamin. Par exemple, cette scène de la « lecture mise en espace » (j’adore ce genre d’expression toute faite!) ou le « bord plateau » . La scène de la lecture m’amuse particulièrement : les comédiens portent des lunettes très sérieusement en lisant un texte complètement débile. Ce décalage me fait beaucoup rire !
C’est une façon de rire ouvertement de ces gens qui se prennent au sérieux alors que finalement, ils ne font pas bouger grand-chose.
Vous insistez beaucoup sur l’absurdité de certaines contraintes liées au monde du théâtre, notamment celle de devoir présenter un « résultat » après deux semaines de résidence.
Cette inspiration vient-elle d’un traumatisme ?
Certainement ! Je pense que c’est un traumatisme pour absolument tous les théâtreux à qui ont a demandé l’exercice rituel de la sortie de résidence. Ça fait partie du deal : on est accueillis par exemple une quinzaine de jours dans un lieu et en échange, ce n’est pas obligatoire, mais on nous conseille fortement de montrer quelque chose. Et que ce sera bon pour nous, la compagnie. Ce qui est vrai en un sens, je suis assez friand de contacts avec le public. Mais il faudrait parfois ne rien présenter tant que ce n’est pas fini : ça nous est arrivé de présenter un travail qui n’avait aucun intérêt pour la personne lambda. Cela crée un malentendu, une tension entre le public et les acteurs. Ce qui peut aussi s’avérer amusant : chacun reste sur ses attentes. La compagnie fait semblant d’avoir des choses à montrer pour justifier les 15 jours alors qu’à ce stade ce n’est souvent pas montrable !
Ça faisait longtemps que j’avais dans mes petites notes cette idée d’organiser une fausse sortie de résidence. Voilà qui est fait !
Presque 15 ans après que vous ayez lancé les manifs de droite, avec des slogans qui pourraient encore être d’actualités (« la culture, ça fait mal à la tête », « faites des enfants, pas des intermittents» ou encore « pas d’alloc pour les dreadlocks »)
Diriez-vous qu’il y a un fond politique dans vos pièces ?
Je pense que lorsque l’on a la prétention de réunir plusieurs centaines de personnes dans un même lieu pour leur dire des choses, c’est politique. Après, c’est peut-être un peu timoré de ma part, mais j’ai toujours essayé de garder une vraie distance avec la politique, en tout cas la politique politicienne. Je ne délivre jamais de messages clairs, unanimes ou en tout cas univoques. C’est vrai que notre rôle est de remuer tout ça et de faire ressortir des gros grumeaux pour mettre en évidence ce qui pose problème.
Les manifs de droite (vers 2003), c’était de la pure satire ! A priori, ce n’était pas tant politique, c’était surtout une sorte de miroir dressé devant nos opposants, devant les arguments que l’on nous opposait et qui étaient absurdes ! Les arguments de droite, il faut le reconnaître.
C’est surtout que c’était l’époque du MEDEF qui ne voulait plus assumer les conventions de l’Unédic et toutes ces choses…
Et quand j’ai vu arriver les manifs pour tous, j’ai été souvent sollicité et beaucoup de gens pensaient que j’avais monté le coup de l’oiseau (« Un papa, une maman, on ne ment pas aux enfants » avec mise en scène en costume d’oiseau NDLR) C’était magnifique !
On vit une époque assez marrante où le premier et le second degré se mélangent de façon tellement fine que l’on s’y perd ! Qu’est-ce que la réalité : le premier, le second ou le troisième degré… ?
Justement, concernant le premier et second degré : qui citeriez-vous comme inspiration(s) en matière d’humour ?
L’humour évolue énormément. Je cite toujours les Monty Python qui m’ont beaucoup influencé. Il y a des choses excellentes dans les séries américaines et malheureusement assez peu en France.
Sur le rapport d’ambiguïté et le canular, il y a finalement assez peu de gens qui le manipulent bien. C’est délicat et très peu payant (au sens premier du terme !) Il faut aimer faire des farces et surtout que ce soit fin et tranchant.
Là-dessus, les Yes Men font un travail très intéressant.
Après le film Le Grand Phoque Asthmatique, avez-vous envie de retenter une expérience autour de la vidéo ou du cinéma ?
Ça fait vraiment partie des choses que j’aimerais faire personnellement, ça m’intéresse beaucoup. Mais je ne pense pas que ce soit très bon pour la compagnie. C’est une histoire d’image. C’est d’ailleurs ce qui constitue notre « trésor de guerre » : l’image que l’on donne aux gens, c’est que l’on échappe à cette classification, que l’on résiste à l’écran.
Ce n’est pas le même boulot, ces deux mondes peuvent même parfois être assez opposés.
Quand les gens viennent nous voir, ils sortent de leur télé, de leurs écrans.
Et plus les écrans proliféreront, plus notre art sera indispensable !
A bien y réfléchir, et puisque vous soulevez la question, il faudra quand même trouver un titre un peu plus percutant par les 26000 couverts
A voir au Carré de Saint-Médard-en-Jalles samedi 11 février à 20h30 et dimanche 12 février à 17h